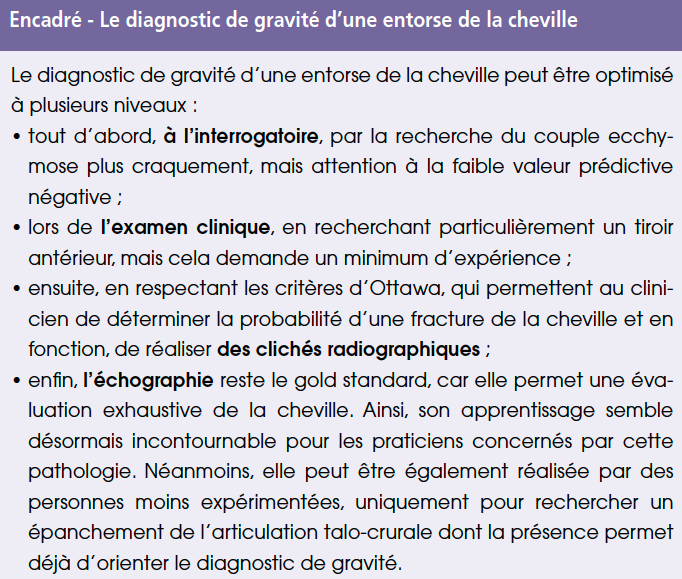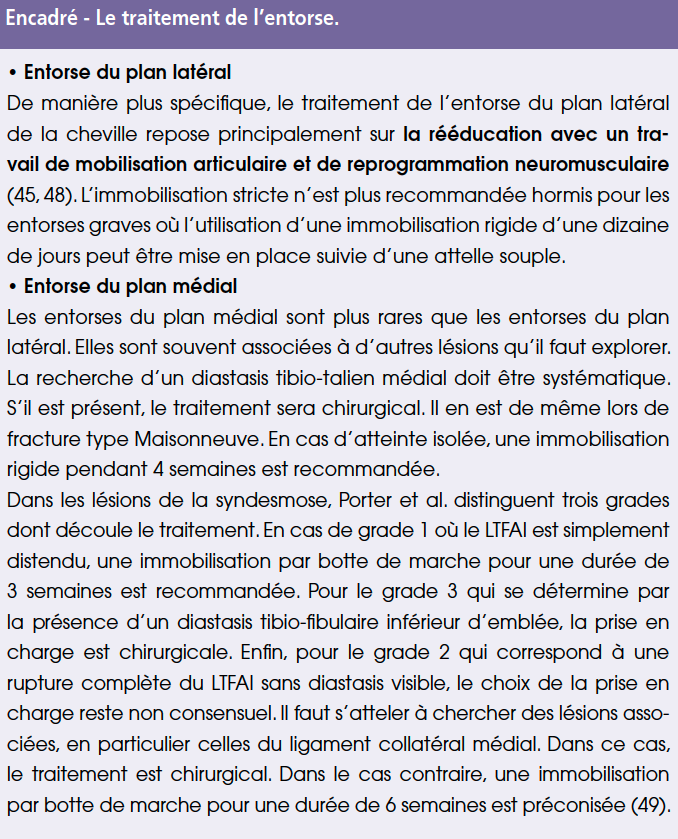Bonnes pratiques et prise en charge de l’entorse de cheville
De l’accident de terrain à la reprise du sport
L’entorse de cheville est le traumatisme le plus fréquent en France, représentant environ 6 000 lésions par jour (1). Son incidence journalière est estimée à 1/12 000 habitants/jour en France. On estime que 70 % de la population générale a déjà subi une blessure de la cheville au cours de sa vie et que cette pathologie représente à elle seule 25 % de l’ensemble des traumatismes chez le sportif (2, 3). Les sports les plus touchés sont le basket-ball, le volley-ball, et le football (4, 5).
Introduction
Retentissement économique
Le retentissement économique associé à cette pathologie n’est pas négligeable. En France, le coût journalier de la prise en charge des entorses de chevilles est estimé à 1,2 million d’euros (6). En 1996, De Bie et al. ont montré qu’un quart des patients victimes d’entorse de la cheville présenteront un absentéisme scolaire ou professionnel de 7 jours en moyenne (7).
Conséquences à long terme
La cheville est soumise à des contraintes de charge par unité de surface plus élevées que ne l’est n’importe quelle articulation du corps humain et elle subit également plus de traumatismes comparativement aux autres articulations. Cependant, la prévalence de la cheville dégénérative symptomatique est neuf fois moins élevée que celles de la hanche ou du genou (8). Ainsi, les conséquences à long terme peuvent paraître acceptables et l’entorse de cheville continue à être banalisée. Pour autant, les blessures par entorse latérale de la cheville ont le taux de rechute le plus élevé de toutes les blessures musculo-squelettiques des membres inférieurs. Les personnes concernées par cette lésion ont un risque deux fois plus élevé de se blesser à nouveau dans l’année qui suit leur blessure initiale (9, 10). En 2013, Guillodo et al. ont mis en évidence que seule la moitié des patients ayant présenté une entorse de cheville estime avoir récupéré totalement à 1 an. À l’inverse, 37 % d’entre eux restaient douloureux, 48 % présentaient une instabilité de cheville et 8,9 % étaient victimes de récidive (11). Ces résultats sont en accord avec la littérature internationale (12, 13). Or la cheville chronique est souvent liée à une erreur de prise en charge initiale, avec notamment une mauvaise évaluation de la gravité et un traitement mal adapté.
Afin de limiter ces complications, il est impératif d’optimiser la prise en charge initiale des traumatismes aigus de la cheville en confirmant le diagnostic et en évaluant précisément la sévérité.
Prise en charge initiale et diagnostic lésionnel
L’interrogatoire
L’interrogatoire est un temps fondamental qui détermine le mécanisme lésionnel et recherche les antécédents du patient. Le mécanisme de la lésion donne au clinicien une indication des structures anatomiques susceptibles d’avoir subi une agression, et donc des structures à privilégier lors de l’évaluation clinique.
La recherche d’antécédents
La recherche d’antécédents, notamment d’entorse de la cheville, est indispensable pour deux raisons :
• il a été établi que les antécédents d’entorse latérale de la cheville augmentent le risque de récidive (13) ;
• en outre, si le patient a déjà subi ce traumatisme, il est probable qu’il présente des déficiences mécaniques et sensorielles associées à la blessure qui doivent être traitées dans le cadre d’un programme de rééducation complet (14).
La recherche de critères de gravité
L’interrogatoire permet également de rechercher systématiquement les critères de gravité tels que :
• la douleur (EVA > 6/10),
• la perception d’un craquement,
• le gonflement immédiat,
• l’impotence fonctionnelle
• ou encore l’apparition d’une ecchymose ou d’un hématome.
En 2016, une étude brestoise a mis en évidence que le craquement et l’hématome, avec une spécificité de 90 %, étaient les signes les plus discriminants pour différencier une entorse bénigne d’une entorse grave (rupture partielle ou complète du LTFA) (15). En revanche, la sensibilité n’était que de 36 %. En effet, 41 % des patients présentant une entorse grave n’avaient pas d’hématome et 36 % n’avaient pas perçu ou entendu de craquement. Ainsi, l’interrogatoire seul semble insuffisant.
L’examen physique
L’examen physique doit être méthodique et répété. Un premier diagnostic de gravité, dans les suites immédiates du traumatisme, peut être réalisé sur le terrain. En revanche, pour certains praticiens, compte tenu des douleurs ou du gonflement articulaire, le contrôle clinique, en particulier la recherche de laxité, devient difficile à réaliser quelques minutes après la blessure (16). De ce fait, un nouvel examen devra être réalisé entre 3 et 6 jours à partir de la date du traumatisme.
La palpation
Une déformation, un empâtement ou également une plaie seront recherchés à l’inspection. Seront examinés à la palpation les trajets ligamentaires (LCL, LCM, syndesmose tibio-fibulaire), les trajets tendineux au nombre de onze, ainsi que les reliefs osseux (bord postérieur des deux malléoles sur 6 cm, la base du 5e métatarsien et l’os naviculaire) qui entrent dans les critères d’Ottawa (17).
Les tests de stabilité clinique
La reproduction de la douleur à la palpation et/ou à la mise en tension d’une structure ligamentaire ou tendineuse indique une lésion de celle-ci. Plus spécifiquement, les tests de stabilité clinique pour évaluer la rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur sont mieux réalisés entre 4 et 6 jours après la blessure ou immédiatement sur le terrain, au moment de la lésion comme de nombreux tests cliniques de laxité (18). Le test du tiroir antérieur est le test de stabilité clinique le plus sensible pour évaluer la rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur. La sensibilité et la spécificité de ce test sont respectivement de 96 et 84 %, avec un rapport de vraisemblance négatif associé de 0,433 (19). Cela signifie que si le test du tiroir antérieur est négatif, il est peu probable que le ligament talo-fibulaire antérieur soit complètement rompu.
Van Dijk et al. ont réalisé en 1996 une étude prospective sur 160 patients évaluant les signes cliniques dans l’entorse grave de la cheville. Leur étude a mis en évidence que l’ecchymose et l’œdème immédiat ou différé étaient associés à une rupture du LTFA, ce qui concorde avec l’étude menée par Scourzic et al. En revanche, contrairement à l’étude brestoise de 2016, Van Djik et al. indiquent que l’impotence fonctionnelle totale est également corrélée à la gravité de l’entorse alors que le craquement ne l’est pas. De plus, lorsque l’examen clinique de la cheville était réalisé par un médecin expérimenté, la combinaison d’une douleur à la palpation au site de la lésion talo-fibulaire antérieure, d’un hématome et d’un test de tiroir antérieur positif donnait une incidence de 95 % d’une lésion ligamentaire certaine (15, 18). Ainsi, la laxité articulaire doit être testée et reste indispensable pour établir le diagnostic de gravité d’une entorse.
Les articulations sus et sous-jacentes
L’examen physique ne s’arrête pas à l’étude de l’articulation talo-crurale et doit se prolonger sur les articulations sus et sous-jacentes.
• Concernant les lésions de la syndesmose, dont la prévalence est de 20 % (20), Sman et al. ont rapporté que la sensibilité localisée à la palpation du LTFAI est le test d’évaluation clinique le plus sensible (sensibilité = 92 %), tandis que le test de compression est le test d’évaluation clinique le plus spécifique (spécificité = 88 %) (21). Ainsi, si la palpation du LTFAI est douloureuse et que le test de compression est positif, il y a une forte probabilité de lésion de la syndesmose.
• Quant aux entorses de l’interligne de Chopart, l’inversion est le mécanisme lésionnel le plus courant, d’où son association fréquente aux entorses latérales de la cheville. Cependant, elles sont généralement plus graves et l’examen clinique et les radiographies restent souvent insuffisants pour établir le diagnostic. Ainsi, 20 à 41 % de ces lésions sont initialement méconnues (22). Cela a pour conséquence la mise en place d’un traitement inadapté et des séquelles à long terme (23). Dans leur étude portant sur une population de footballeurs professionnels, Leiderer et al. ont montré que le retour au terrain était significativement plus important chez les joueurs cumulant une entorse de la cheville et une lésion du Chopart (47 jours) comparés à ceux ayant une lésion isolée de la cheville (24 jours) (24).
Une autre étude réalisée en 2016 recommande la réalisation d’une échographie systématique devant la présence d’une impotence du pied et d’une douleur à la mobilisation du médio-tarse après un mécanisme en hyperflexion plantaire afin de réaliser un diagnostic plus précis (25). Enfin, le gold standard des blessures du médio-pied reste l’IRM qui permet une évaluation simultanée du degré d’atteinte des parties molles et des os (22).
Évaluation de la gravité
La fracture : la radiographie
Les clichés radiographiques ne sont pas systématiques face à une entorse de la cheville. Bien qu’ils ne précisent pas la gravité d’une entorse, les critères d’Ottawa, définis en 1992, doivent être utilisés pour déterminer la probabilité d’une fracture de l’articulation de la cheville (17). Si l’un des critères est rempli, des radiographies de face neutre, de face en rotation médiale de 20° et de profil de la cheville devront être réalisées. En revanche, compte tenu d’une sensibilité plus élevée que la spécificité, si aucun des critères n’est rempli, la probabilité de fracture de la cheville est inférieure à 1 % et il n’est pas nécessaire de réaliser de radiographies (26).
À noter que le critère d’âge ne figure plus dans les critères d’Ottawa car cette règle de prescription a été validée chez l’enfant (27, 28).
La lésion ligamentaire : l’échographie
Après avoir écarté une fracture, un bilan ligamentaire complet est recommandé pour déterminer la gravité d’une entorse de la cheville. L’échographie est le gold standard pour cela. Elle permet également d’établir les diagnostics différentiels qui modifieront le traitement si besoin.
En revanche, cet examen nécessite d’être réalisé par une personne expérimentée bénéficiant d’une machine adaptée. Malgré tout, une échographie “simple” à la recherche d’un épanchement articulaire est toujours possible, même par des médecins peu expérimentés. En effet, Guillodo et al. ont montré en 2007 que la présence d’un épanchement de l’articulation talo-crurale à la suite d’une entorse de la cheville était très fortement prédictif d’une lésion ligamentaire certaine (valeur prédictive proche de 100 %). À cette lésion ligamentaire était associée une lésion chondrale ou une contusion osseuse dans 35 % des cas (29). De cette façon, il est possible d’orienter le diagnostic de gravité.
Lorsque l’échographie est réalisée par un médecin expérimenté, elle permet de faire un bilan complet des structures tendineuses et ligamentaires de la cheville en étudiant, en particulier, la syndesmose tibio-fibulaire inférieure, les ligaments des articulations talo-crurale et sous-talienne ainsi que les tendons fibulaires qui peuvent se luxer.
Traitement
Le protocole POLICE
Une fois les diagnostics différentiels écartés, le protocole POLICE est mis en place à la phase aiguë (30). Comme pour de nombreuses lésions musculo-squelettiques, il comprend :
• des glaçages itératifs de l’articulation,
• une compression par des bandes cohésives,
• une surélévation du membre inférieur pour drainer l’œdème,
• une protection de la cheville
• et la mise en appui dès que possible avec l’aide de cannes anglaises si besoin.
Toutefois, les preuves des effets de la cryothérapie et de la compression par bandes restent limitées (31, 32).
Le traitement médicamenteux
Sur le plan médicamenteux, les antalgiques, notamment les paliers 1, sont prescrits dans une grande majorité des cas. Il peut s’y associer une mise sous anticoagulants en cas de décharge complète du membre inférieur concerné. Au sujet des anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie orale, les avis divergent. Certaines études ont montré qu’ils permettaient une limitation de la formation d’œdème, une diminution de la douleur et une reprise plus rapide de l’activité sportive (33, 34). Inversement, Stovitz et al. indiquent que ces médicaments diminueraient l’apport d’éléments sanguins nécessaires à une cicatrisation optimale et ne sont donc pas recommandés en phase aiguë (35). Par voie cutanée, il n’a pas été démontré d’effet bénéfique (36).
Le traitement fonctionnel ou orthopédique
Actuellement, la majorité des entorses de chevilles fait l’objet d’une prise en charge fonctionnelle ou orthopédique. Le traitement fonctionnel est privilégié aujourd’hui, car il permettrait de meilleurs résultats avec un retour au terrain au même niveau plus rapide que le traitement orthopédique (37-39). Cependant, certains auteurs mettent en avant que l’immobilisation rigide de courte durée dans les entorses graves (< 10 jours) permet une réduction significative de l’œdème, des douleurs et améliore le résultat fonctionnel (40, 41). Ainsi, le choix entre un traitement fonctionnel ou orthopédique n’est pas encore clair. Une approche combinant une immobilisation rigide de courte durée relayée par attelle souple semble être un bon compromis pour ces lésions.
La kinésithérapie
Dans la prise en charge fonctionnelle, la kinésithérapie a un rôle essentiel. Elle doit être la plus précoce possible avec, dans un premier temps, un travail de drainage de l’œdème permettant une diminution de la douleur ainsi qu’un gain fonctionnel en termes d’amplitude articulaire (42, 43). Ensuite, la mise en place d’une rééducation neuromusculaire et proprioceptive permettra de réduire l’instabilité, d’améliorer les résultats fonctionnels et de prévenir les récidives (44, 45).
Les thérapies annexes
Comme pour d’autres thérapies annexes telles que les ultrasons, les thérapies laser, l’électrostimulation ou encore l’oxygénation hyperbare, les preuves de l’efficacité de l’acupuncture dans la prise en charge de l’entorse de cheville ne sont pas concluantes. Ceci s’explique en partie par un manque d’études sur ces sujets (46, 47).
Le traitement chirurgical
Le traitement chirurgical reste exceptionnel. Il peut concerner les entorses latérales graves (rupture du LTFA et du LCF) chez les sportifs de haut niveau pour assurer un retour sur les terrains plus rapide (50). Nous pensons que, dans ce cas, une réunion de concertation entre le médecin, le chirurgien et le patient est nécessaire. La prise en charge chirurgicale est également indiquée dans les entorses auxquelles sont associées des fractures ostéochondrales du talus, aux cas chroniques d’instabilité réfractaire et, comme vu précédemment, dans les lésions de la syndesmose ou du plan médial lorsqu’un diastasis est présent.
Conclusion
L’entorse de cheville, véritable enjeu de santé publique par sa fréquence, reste mal codifiée dans sa prise en charge pour beaucoup de médecins. Par conséquent, des traitements mal adaptés sont mis en place et entraînent des séquelles à long terme qui ont tendance à être sous-estimées. De ce fait, l’optimisation du diagnostic de gravité de l’entorse de cheville est un enjeu majeur. Elle passe principalement par le perfectionnement de l’examen clinique et la généralisation de l’échographie. À cela s’ajoutent des controverses et un manque de preuves concernant certaines thérapeutiques. Dans ce contexte, de nouvelles études et un nouveau consensus sur ces sujets semblent nécessaires.
Bibliographie
1. Bertini N, Bleichner G, Cannamela A et al. L’entorse de cheville au service d’accueil et d’urgence. Réanimation Urgences 1995 ; 4 : 491‑501.
2. O’Loughlin PF, Murawski CD, Egan C, Kennedy JG. Ankle instability in sports. Phys Sportsmed 2009 ; 37 : 93‑103.
3. Hiller CE, Nightingale EJ, Raymond J et al. Prevalence and impact of chronic musculoskeletal ankle disorders in the community. Arch Phys Med Rehabil 2012 ; 93 : 1801‑7.
4. Fong DT-P, Hong Y, Chan L-K et al. A systematic review on ankle injury and ankle sprain in sports. Sports Med 2007 ; 37 : 73‑94.
5. Doherty C, Delahunt E, Caulfield B et al. The incidence and prevalence of ankle sprain injury: a systematic review and meta-analysis of prospective epidemiological studies. Sports Med 2014 ; 44 : 123‑40.
6. Gribble PA, Bleakley CM, Caulfield BM et al. Evidence review for the 2016 International Ankle Consortium consensus statement on the prevalence, impact and long-term consequences of lateral ankle sprains. Br J Sports Med 2016 ; 50 : 1496‑505.
7. de Bie R, de Vet H, van den Wildenberg F et al. the prognosis of ankle sprains. Int J Sports Med 1997 ; 18 : 285‑9.
8. Thomas RH, Daniels TR. Ankle arthritis. J Bone Surg Am 2003 ; 85 : 923‑36.
9. Anandacoomarasamy A. Long term outcomes of inversion ankle injuries. Commentary. Br J Sports Med 2005 ; 39 : e14.
10. Verhagen EALM. An economic evaluation of a proprioceptive balance board training programme for the prevention of ankle sprains in volleyball. Br J Sports Med 2005 ; 39 : 111‑5.
11. Guillodo Y, Simon T, Le Goff A, Saraux A. Interest of rehabilitation in healing and preventing recurrence of ankle sprains. Ann Phys Rehabil Med 2013 ; 56 : 503‑14.
12. Kerkhoffs GM, van den Bekerom M, Elders LAM et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med 2012 ; 46 : 854‑60.
13. Tyler TF, Mchugh MP, Mirabella MR et al. Risk factors for noncontact ankle sprains in high school football players: the role of previous ankle sprains and body mass index. Am J Sports Med 2006 ; 34 : 471‑5.
14. Hertel J. Functional anatomy, pathomechanics, and pathophysiology of lateral ankle instability. J Athl Train 2002 ; 37 : 364‑75.
15. Scourzic A, Guillodo Y, Combes L et al. Valeur diagnostique d’un auto-questionnaire dans l’entorse récente de la cheville [Étude prospective monocentrique]. [Brest] : UBO 2017.
16. Banihachemi JJ, Courtois G, Ravey JN et al. Pertinence de l’examen clinique en urgence pour le diagnostic des ruptures des faisceaux antérieur et moyen du ligament collatéral latéral de la cheville. J Traumatol Sport 2020 ; 37 : 80‑7.
17. Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD et al. A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries. Ann Emerg Med 1992 ; 21 : 384‑90.
18. van Dijk CN, Lim LSL, Bossuyt PMM, Marti RK. Physical examination is sufficient for the diagnosis of sprained ankles. J Bone Joint Surg Br 1996 ; 78 : 958‑62.
19. Delahunt E, Bleakley CM, Bossard DS et al. Clinical assessment of acute lateral ankle sprain injuries (ROAST): 2019 consensus statement and recommendations of the International Ankle Consortium. Br J Sports Med 2018 ; 52 : 1304‑10.
20. Roemer FW, Jomaah N, Niu J et al. Ligamentous injuries and the risk of associated tissue damage in acute ankle sprains in athletes: a cross-sectional MRI study. Am J Sports Med 2014 ; 42 : 1549‑57.
21. Sman AD, Hiller CE, Rae K et al. Diagnostic accuracy of clinical tests for ankle syndesmosis injury. Br J Sports Med 2015 ; 49 : 323‑9.
22. Kutaish H, Stern R, Drittenbass L, Assal M. Injuries to the Chopart joint complex: a current review. Eur J Orthop Surg Traumatol 2017 ; 27 : 425‑31.
23. van Dorp KB, de Vries MR, van der Elst M, Schepers T. Chopart joint injury: a study of outcome and morbidity. J Foot Ankle Surg 2010 ; 49 : 541‑5.
24. Leiderer MT, Welsch GH, Molwitz I et al. Magnetic resonance imaging of midtarsal sprain: Prevalence and impact on the time of return to play in professional soccer players. Eur J Radiol 2021 ; 135 : 109491.
25. Thiounn A, Szymanski C, Lalanne C et al. Prospective observational study of midtarsal joint sprain: Epidemiological and ultrasonographic analysis. Orthop Traumatol Surg Res 2016 ; 102 : 657‑61.
26. Beckenkamp PR, Lin C-WC, Macaskill P et al. Diagnostic accuracy of the Ottawa Ankle and Midfoot Rules: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med 2017 ; 51 : 504‑10.
27. Rodrigues P, João C, Delfin T et al. Validation des règles d’Ottawa pour les traumatismes de cheville chez la population pédiatrique au Portugal. Rev Chir Orthop Traumatol 2016 ; 102 : S100.
28. Libetta C, Burke D, Brennan P, Yassa J. Validation of the Ottawa ankle rules in children. Emerg Med J 1999 ; 16 : 342‑4.
29. Guillodo Y, Riban P, Guennoc X et al. Usefulness of ultrasonographic detection of talocrural effusion in ankle sprains. J Ultrasound Med 2007 ; 26 : 831‑6.
30. Bleakley CM, Glasgow P, MacAuley DC. PRICE needs updating, should we call the POLICE? Br J Sports Med 2012 ; 46 : 220‑1.
31. Bleakley CM. Cryotherapy for acute ankle sprains: a randomised controlled study of two different icing protocols. Commentary. Br J Sports Med 2006 ; 40 : 700‑5.
32. Airaksinen O, Kolari PJ, Miettinen H. Elastic bandages and intermittent pneumatic compression for treatment of acute ankle sprains. Arch Phys Med Rehabil 1990 ; 71 : 380‑3.
33. van den Bekerom MPJ, Sjer A, Somford MP et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating acute ankle sprains in adults: benefits outweigh adverse events. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015 ; 23 : 2390‑9.
34. Ekman EF, Fiechtner JJ, Levy S, Fort JG. Efficacy of celecoxib versus ibuprofen in the treatment of acute pain: a multicenter, double-blind, randomized controlled trial in acute ankle sprain. Am J Orthop 2002 ; 31 : 445‑51.
35. Stovitz SD, Johnson RJ. NSAIDs and musculoskeletal treatment: what is the clinical evidence? Phys Sportsmed 2003 ; 31 : 35‑52.
36. Lai PM, Collaku A, Reed K. Efficacy and safety of topical diclofenac/menthol gel for ankle sprain: A randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J Int Med Res 2017 ; 45 : 647‑61.
37. Jones MH, Amendola AS. Acute treatment of inversion ankle sprains: immobilization versus functional treatment. Clin Orthop 2007 ; 455 : 169‑72.
38. Prado MP, Mendes AAM, Amodio DT et al. A comparative, prospective, and randomized study of two conservative treatment protocols for first-episode lateral ankle ligament injuries. Foot Ankle Int 2014 ; 35 : 201‑6.
39. Naeem M, Rahimnajjad MK, Rahimnajjad NA et al. Assessment of functional treatment versus plaster of Paris in the treatment of grade 1 and 2 lateral ankle sprains. J Orthop Traumatol 2015 ; 16 : 41‑6.
40. Lamb S, Marsh J, Hutton J et al. Mechanical supports for acute, severe ankle sprain: a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2009 ; 373 : 575‑81.
41. Chen ET, McInnis KC, Borg-Stein J. Ankle sprains: evaluation, rehabilitation, and prevention. Curr Sports Med Rep 2019 ; 18 : 217‑23.
42. Loudon JK, Reiman MP, Sylvain J. The efficacy of manual joint mobilisation/manipulation in treatment of lateral ankle sprains: a systematic review. Br J Sports Med 2014 ; 48 : 365‑70.
43. Brison RJ, Day AG, Pelland L et al. Effect of early supervised physiotherapy on recovery from acute ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ 2016 ; 355 : i5650.
44. Rivera MJ, Winkelmann ZK, Powden CJ, Games KE. Proprioceptive training for the prevention of ankle sprains: an evidence-based review. J Athl Train 2017 ; 52 : 1065‑7.
45. Postle K, Pak D, Smith TO. Effectiveness of proprioceptive exercises for ankle ligament injury in adults: A systematic literature and meta-analysis. Man Ther 2012 ; 17 : 285‑91.
46. Kim T-H, Lee MS, Kim KH et al. Acupuncture for treating acute ankle sprains in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014.
47. Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med 2017 ; 51 : 113‑25.
48. Zech A, Hübscher M, Vogt L et al. Neuromuscular training for rehabilitation of sports injuries: a systematic review. Med Sci Sports Exerc 2009 ; 41 : 1831‑41.
49. Porter D, Rund A, Barnes AF, Jaggers RR. Optimal management of ankle syndesmosis injuries. Open Access J Sports Med 2014 ; 5 : 173-82.
50. Petersen W, Rembitzki IV, Koppenburg AG et al. Treatment of acute ankle ligament injuries: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg 2013 ; 133 : 1129‑41.