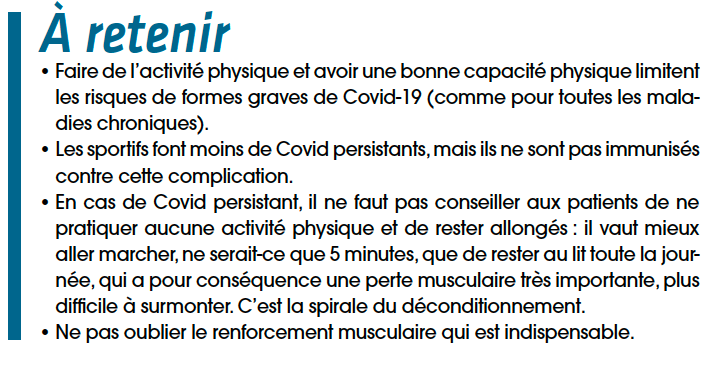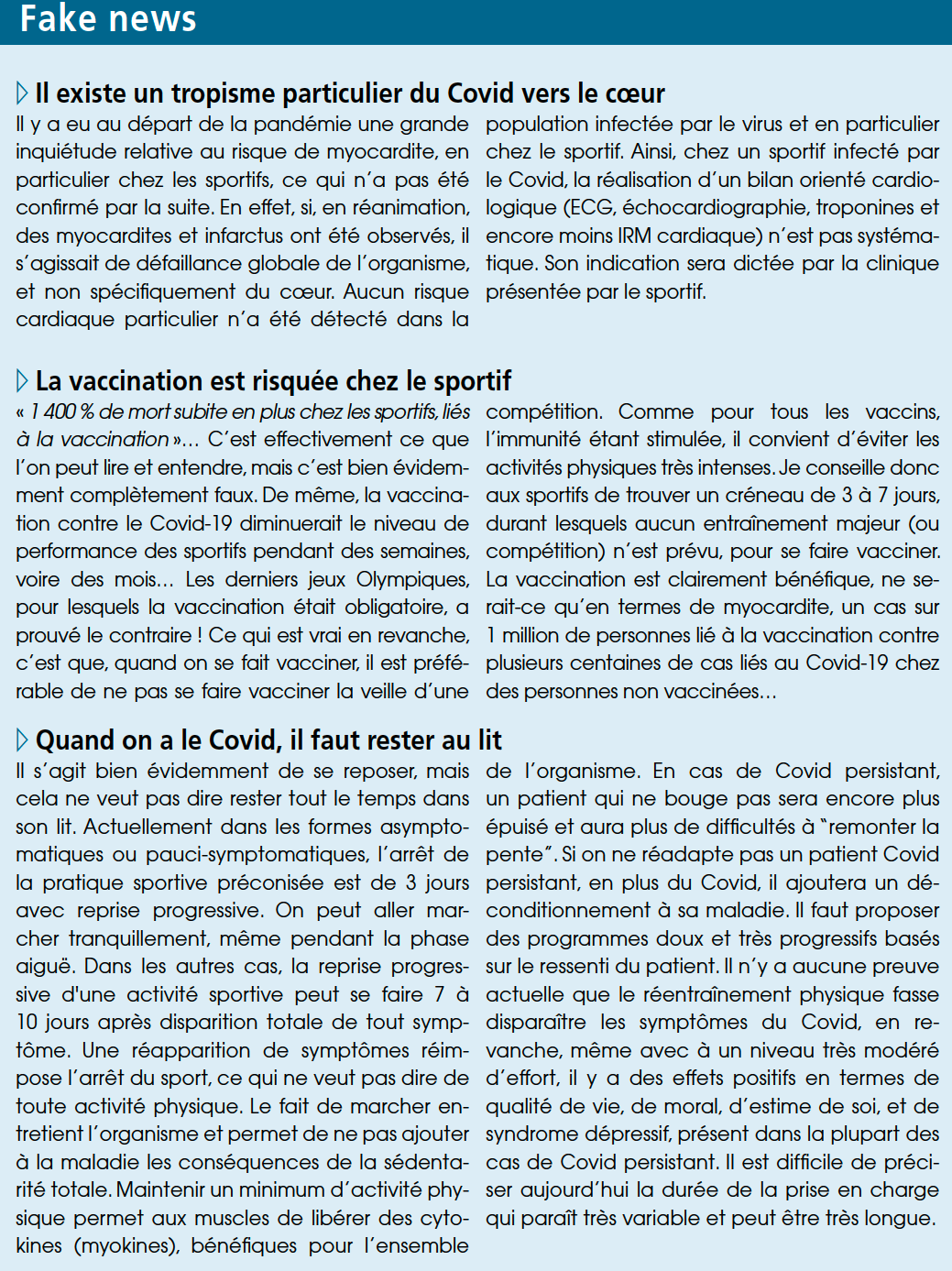Le Covid long chez les sportifs – Quelles spécificités ? Quelle prise en charge ?
Plus de 2 ans après son apparition, le Covid-19 fait encore et toujours parler de lui. Ses variants, ses mécanismes d’action, ses effets sur les organismes… autant d’aspects qui ne sont pas encore aujourd’hui parfaitement connus et maîtrisés. De plus, certains patients ressentent encore des symptômes plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été infectés, c’est ce qui est communément appelé “Covid long”. Les sportifs en souffrent-ils également ? Comment les prendre en charge ? Pour y répondre, et afin de démêler le vrai du faux, nous avons interrogé le Pr François Carré, cardiologue au CHU de Rennes dans le service de médecine du sport.
Comment définir un Covid long ?
Pr François Carré : La définition est un peu floue, et a évolué au fil du temps. Je préfère utiliser le terme de “Covid persistant”, qui me paraît plus médical. La HAS parle de symptômes persistants ou prolongés suite à une infection par le Covid-19. Avant tout, il faut une confirmation d’une infection préalable par le Covid : test positif (quand ils ont été disponibles) ou plusieurs symptômes typiques en période d’épidémie (au moins trois). Si l’un des symptômes (ou plusieurs) persiste, et qu’il ne peut pas être expliqué par une autre cause, alors, le Covid persistant peut être évoqué. Le délai de persistance a également évolué : 4 à 12 semaines selon une revue américaine récente. Les symptômes d’un Covid durant généralement de quelques jours à 3 semaines, au-delà de 4 semaines, il convient donc de s’interroger.
Quelles sont les personnes atteintes ?
D’après notre expérience et cela a été confirmé par les dernières données publiées, les femmes, plutôt jeunes (30-45 ans), sportives ou non, seraient plus touchées. De plus, le fait d’avoir eu beaucoup de symptômes lors de la phase aiguë pourrait favoriser le Covid persistant. Une hospitalisation pourrait également être un facteur favorisant.
Quels sont les symptômes ?
Sportifs ou non, certains symptômes prédominent. Le plus souvent, il s’agit d’une fatigue très intense, avec une efficacité médiocre du repos, d’essoufflements, de troubles neurologiques, notamment cognitifs (troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire) ainsi que l’agnosie et l’agueusie. Une sensation de brouillard est également fréquemment rapportée, les Anglais utilisent d’ailleurs le terme de fog. Une douleur thoracique avec une sensation de poids sur la poitrine, mais non liée à l’effort, et des palpitations sont aussi fréquentes. Cette persistance de symptômes concerne environ 10 % de personnes au-delà de 12 semaines et 20 % au-delà de 4 semaines. Certains patients signalent par ailleurs une évolution fluctuante, c’est-à-dire que les symptômes disparaissent, puis reviennent. Il est très important de comprendre que ces symptômes sont bien réels et qu’il faut croire les patients qui s’en plaignent. En effet, ceux-ci rapportent souvent une sensation d’incompréhension de leur famille, de leur environnement professionnel et parfois même… de leur médecin. C’est un peu l’ambiance que l’on peut retrouver dans d’autres pathologies type fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique… Pour ma part, je suis beaucoup de patients qui décrivent des effets similaires avec des symptômes conséquents. Je pense notamment à des sportifs bien entraînés qui ne sont plus en capacité de porter leur enfant sur 500 mètres, alors qu’ils faisaient des marathons quelques mois auparavant.
Comment expliquer cette persistance des symptômes ?
En termes de physiopathologie, force est de reconnaître que l’on ne sait pas très bien ce qu’il se passe. Il convient d’ailleurs de rappeler que ce n’est pas spécifique au Covid. Dans le SARS-CoV-1, des cas de patients fatigués pendant plusieurs années ont été décrits. De même, dans d’autres maladies infectieuses, comme la mononucléose, la fatigue peut persister longtemps, dans l’herpès, les symptômes disparaissent puis reviennent temporairement. Dans les zones touchées par d’autres viroses, comme la dengue, le zyka ou encore le chikungunya, des patients peuvent se plaindre d’une fatigue et/ou de symptômes comme des douleurs ostéoarticulaires pendant très longtemps. Ainsi, il semble que l’on ne guérit pas toujours totalement de l’infection, le virus ne disparaîtrait pas de l’organisme et pourrait rester quiescent au sein de certains organes et se ré-exprimer de temps en temps en cas de périodes de fatigue ou de stress.
Comment les prendre en charge ?
La première chose importante à faire est de ne pas passer à côté des patients sévères, c’est-à-dire qu’il faut toujours, en cas de suspicion, faire les examens complémentaires ciblés. De plus, leur négativité rassure le patient. Il est ainsi recommandé de vérifier la saturation en oxygène au repos et à l’effort. On peut utiliser le test de la chaise avec surveillance par un petit saturomètre placé sur le doigt ou l’oreille. On demande au patient de se lever et se rasseoir rapidement pendant environ 1 minute et on surveille la saturation. En effet, certaines personnes ont une parfaite saturation au repos, mais, au bout de seulement trois ou quatre flexions, ils désaturent de façon très importante, sans être très essoufflés, ce qui fait qu’ils ne s’en rendent pas compte. C’est un signe qui nécessite un bilan pulmonaire complémentaire.
Quels sont les risques de Covid chez les sportifs ?
Avant de répondre précisément à cette question, je tiens à rappeler deux données essentielles à mes yeux. Elles ont pourtant été peu décrites par les médias, qui ont essentiellement évoqué les risques de gravité chez les personnes âgées et/ou présentant des comorbidités.
D’abord, la capacité physique, c’est-à-dire la consommation maximale d’oxygène. Une équipe américaine a montré que, parmi leurs patients Covid, ceux qui avaient une mauvaise capacité physique ont été plus hospitalisés, en particulier en réanimation, que ceux qui avaient une bonne capacité physique alors qu’ils avaient les mêmes comorbidités.
Ensuite, le niveau de pratique d’activité physique des patients est très important. Une autre publication américaine, sur une grande population de 40 000 personnes, a montré que les personnes qui respectent les recommandations, c’est-à-dire les 150 à 300 minutes hebdomadaires d’activité physique modérée ont six fois moins de risque de mourir du Covid que ceux qui ne bougent pas du tout (0,4 versus 2,4 %). À noter que, dans cette étude, il s’agissait de personnes pratiquant moins de 10 minutes de marche par… semaine. Il s’agit des États-Unis, mais nous avons aussi des personnes vraiment sédentaires en France.
Ces éléments confirment, comme l’a proposé Richard Horton, qu’il convient de parler de syndémie liée au SARS-CoV-2, plutôt que de pandémie. La syndémie relie la gravité de la pathologie aux effets de l’agent infectieux combinés à ceux de l’environnement, ici le mode de vie très inactif et sédentaire actuel de la population générale.
À partir de ces données, nous pouvons aujourd’hui conclure que la population sportive est a priori moins à risque de Covid sévère.
Et le Covid persistant chez les sportifs ?
La structure de prise en charge mise en place au CHU de Rennes par les services de médecine physique et réadaptation et de médecine du sport propose aux patients avec Covid persistant, adressés par leur médecin traitant, une visite initiale avec trois parties :
• médicale qui permet de préciser les symptômes dominants, avec demande éventuelle de bilans complémentaires spécialisés, et recherche de troubles cognitifs fréquents qui pourront nécessiter une prise en charge spécifique ;
• psychologique, qui a montré que beaucoup de patients présentent des troubles pouvant nécessiter une prise en charge spécifique ;
• évaluation initiale de la condition physique réalisée par un enseignant d’activité physique adaptée à la santé (APA-S) qui va permettre de proposer un programme d’APA, fondé sur le travail aérobie et le renforcement musculaire, individualisé. Dans le Covid, le renforcement musculaire, en particulier chez les sportifs, est primordial, car l’infection a un effet délétère marqué sur la masse musculaire squelettique. Ce réentraînement sera toujours bénéfique en premier lieu en prévenant le déconditionnement musculaire qui ne fera qu’aggraver les symptômes du Covid.
Au terme du programme (au moins huit séances sur 4 semaines de prise en charge ambulatoire avec possibilité de réaliser l’entraînement physique à domicile), une évaluation finale est réalisée dans les domaines médical, dont cognitif si besoin, psychologique et de la condition physique. Un accompagnement ultérieur individualisé est proposé dans le but d’une poursuite d’APA autonome sécure.
Nous avons observé des cas de Covid persistants chez les sportifs, qui ne sont donc pas épargnés, mais ils restent bien plus rares que dans la population générale.
Existe-t-il plusieurs profils de Covid persistant ?
D’après notre expérience, comme dans d’autres équipes, plusieurs phénotypes, observés aussi dans la population générale, peuvent être décrits. Il convient de les distinguer, car ils vont bénéficier d’une prise en charge spécifique. À noter que beaucoup de patients présentent des troubles psychologiques pouvant nécessiter une prise en charge spécifique.
• Le premier phénotype est marqué par une fatigabilité musculaire largement prédominante, voire isolée, sans trouble cardiovasculaire ni respiratoire associé. L’interrogatoire est primordial pour préciser le type de la fatigabilité avec prise en charge adaptée. Il peut s’agir d’une fatigabilité journalière matinale, précoce progressivement invalidante, mais stable dans son mode d’expression. Pour l’entraînement aérobie, nous privilégions le fractionné, avec 6 à 12 répétitions de courte durée (20-45 s) d’alternance exercices intenses/récupération active qui apparaît mieux toléré que les efforts prolongés (15-30 min) à intensité constante. Une autre forme de fatigabilité, qualifiée de pseudo-addisonnienne, du fait de sa symptomatologie proche de la maladie d’Addison, est observée. Les patients se lèvent en bonne forme, ce qui les rassure, mais cette énergie s’épuise rapidement avec une fatigue majeure qui apparaît rapidement au cours de la journée. Les 2 jours suivants, ils ne peuvent pratiquement plus faire d’activité. Il faut leur apprendre à gérer leur capacité d’énergie même s’ils se sentent bien pour éviter ce contrecoup très difficile à gérer psychologiquement. Nous travaillons en ce sens sur l’éducation thérapeutique et nous les réentraînons très doucement en endurance et renforcement musculaire (marche très lente, pédalage allongé, rameur léger) avec encadrement par l’enseignant APA-S. Certaines équipes associent parfois une corticothérapie au réentraînement.
• Le deuxième phénotype correspond à une inadaptation de la fréquence cardiaque à l’effort, avec un cœur anormalement rapide au repos associé à une tachycardie sinusale inappropriée au niveau d’effort réalisé. Des phénomènes arythmiques doivent être éliminés. Dans ce phénotype, la perturbation serait d’origine neurologique liée à un trouble du contrôle autonomique de la fréquence cardiaque. Le tonus sympathique, qui favorise les arythmies, prédominant sur le parasympathique. Le réentraînement individualisé, encadré par un enseignant APA, associe endurance et renforcement musculaire. La fréquence cardiaque doit être surveillée pendant l’effort. Il peut être utile, quand le patient supporte mal la tachycardie sinusale d’effort, de prescrire un médicament bradycardisant.
• Dans le troisième phénotype, les inadaptations de la ventilation à l’effort prédominent. Les patients, plus ou moins essoufflés au repos, hyperventilent à l’effort de manière inadaptée par rapport à son intensité, mais sans désaturation associée. Ces troubles de régulation de la ventilation ont a priori une origine neurologique. Un bilan d’exploration pulmonaire peut être justifié surtout en cas de symptômes pulmonaires marqués lors de la phase d’infection aiguë. Nous proposons un réentraînement avec les enseignants APA sous surveillance de la saturation. La kinésithérapie ventilatoire bien réalisée montre de bons résultats et peut être proposée en amont du réentraînement dans les cas de symptomatologie majeure.
Les patients qui associent hyperventilation et désaturation doivent toujours bénéficier d’un bilan pneumologique avec exploration fonctionnelle respiratoire et une prise en charge pour kinésithérapie ventilatoire.
• Le dernier phénotype observé concerne les patients avec des troubles à prédominance cognitive, en particulier de mémoire. Leur importance peut perturber les patients. Il faut les rassurer et leur expliquer qu’ils sont réversibles. Il convient de les réentraîner à la fois sur le plan physique et sur le plan cognitif. Cette prise en charge, réalisée dans les services de médecine physique et réadaptation, apparaît très efficace. Des formes de Covid avec neuropathies périphériques sont aussi rapportées. Après leur bilan, une prise en charge en médecine physique et réadaptation pourra se révéler efficace.