Les luxations du genou : quelle prise en charge ?
Les luxations du genou sont rares, toutefois, l’évolution des pratiques sportives et la pratique de plus en plus développée des sports extrêmes rendent cette entité lésionnelle de plus en plus fréquente. Initialement l’apanage de la traumatologie routière, la fréquence de la luxation de genou ne cesse de croître avec l’augmentation de l’intensité et de l’engagement physique dans les sports de combat (MMA, judo, lutte…) et dans les sports de contact (rugby, football américain…). La luxation du genou correspond par définition à une perte de congruence articulaire des surfaces cartilagineuses fémoro-tibiales (seront exclues ici les luxations fémoro-patellaires). Le pronostic de ces luxations du genou reste réservé, toutefois il peut être nettement amélioré par une analyse et un diagnostic précoce avec une prise en charge initiale urgente et adaptée. De la mise en place de la prise en charge sur le terrain dépendra le pronostic fonctionnel à court et moyen termes.
Objectifs de la prise en charge
Réduction et correction de la déformation
Devant une luxation du genou, l’objectif premier de la prise en charge sera de rétablir la congruence articulaire dès que possible. Sur le terrain, il est recommandé d’évacuer l’athlète à l’abri des caméras, permettant un bilan dans le calme à l’extérieur du terrain. Les manœuvres de réduction par traction et correction de la déformation peuvent être tentées “à chaud”.
Transfert vers un centre adapté
En cas d’incarcération d’un plan ligamentaire ou de luxation irréductible et en l’absence de matériel de sédation, il est recommandé d’organiser rapidement le transfert vers un centre adapté. Le transfert doit se faire après information auprès du centre 15 afin d’obtenir un transfert médicalisé vers un centre disposant impérativement d’un plateau technique orthopédique et d’un plateau technique vasculaire.
Traitement des complications vasculaires et associées
En effet, si la réduction de la luxation est la priorité, l’urgence immédiate est représentée par les complications vasculaires. L’objectif sera donc, après réduction, de traiter les complications vasculaires, puis les complications associées telles que les ruptures de l’appareil extenseur, les lésions ou fractures chondrales, les lésions neurologiques.
Reconstruction ligamentaire
Dans un second temps, la reconstruction ligamentaire nécessitera tout d’abord la correction de la laxité postérieure permettant une cicatrisation des plans périphériques en bonne tension. La correction des laxités frontales et notamment la reconstruction du plan ligamentaire latéral seront également l’objectif de la chirurgie ligamentaire. Enfin, la contention permettra d’éviter les déplacements secondaires.
Prise en charge sur le terrain (Fig. 1)
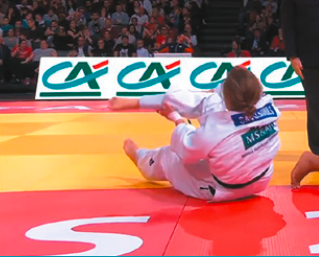
Réduction de la luxation
L’étape urgente est la réduction de la luxation, plus elle est précoce, plus elle diminuera le risque de souffrance cutanée et ligamentaire. En l’absence de réduction précoce sur site, la réduction sera effectuée sous anesthésie par manœuvre externe. Dans certains cas, la réduction peut être compliquée. En cas de luxation ouverte, notamment une ouverture cutanée postérieure sur un mécanisme en hyperextension, la réduction doit être accompagnée de la mise en place précoce d’une antibioprophylaxie et de soins locaux immédiats avec couverture de la plaie pour diminuer le risque d’infection. Parfois, une incarcération du plan ligamentaire médiale rend la luxation impossible à réduire par manœuvre externe et une réduction chirurgicale est nécessaire (Fig. 2).

Évaluation initiale
Évaluation vasculaire
L’évaluation initiale sur le terrain doit faire rechercher une lésion vasculaire par la palpation des pouls distaux. L’évaluation de la vascularisation du membre est indispensable à la prise en charge initiale pour éviter tout retard ou erreur d’orientation vers un plateau technique adapté. En cas d’ischémie aiguë, un transfert médicalisé sans délai et orienté vers un plateau technique avec équipe de chirurgie vasculaire et de chirurgie orthopédique est directement corrélé au pronostic fonctionnel à court terme.
Évaluation neurologique
Une évaluation neurologique immédiate est indispensable, notamment la recherche d’un déficit sensitivo-moteur périphérique dans le territoire du nerf fibulaire commun.
Transfert
Le transfert vers un centre hospitalier se fera après immobilisation dans l’axe par une attelle avec ou sans réduction. En cas de luxation ouverte ou de saignement, préférer une compression de la plaie et éviter un garrot à la racine du membre rendant l’examen vasculaire à l’arrivée plus difficile.
Prise en charge hospitalière à la phase aiguë
En l’absence de pouls
À l’arrivée sur le plateau technique, en l’absence de pouls avec une ischémie de membre évidente, un transfert sans délai au bloc opératoire en double équipe est indispensable pour réduction et/ou stabilisation par fixateur externe du genou avec artériographie sur table et, en fonction, réalisation du traitement chirurgical adapté.
Bilan vasculaire et radiographique
Parfois, la présence d’un pouls filant ou asymétrique peut-être “faussement” rassurant et un bilan vasculaire reste indispensable devant toute luxation du genou réduite ou spontanément réduite. Un angioscanner précoce après réduction et immobilisation devra être réalisé afin d’éliminer en urgence un faux anévrysme par exemple. La radiographie avant et après réduction du genou de face et de profil est indiquée. Celle-ci permettra également de rechercher une fracture associée qui serait passée inaperçue initialement.
Testing ligamentaire
En semi-urgence et après stabilisation du patient, idéalement un testing ligamentaire sous sédation pourra être réalisé immédiatement après réduction permettant d’évaluer la stabilité de la réduction et les laxités avec des clichés radiographiques bilatéraux et comparatifs à la recherche d’une laxité en varus, en valgus, en tiroir postérieur et en tiroir antérieur (Fig. 3).

Scanner et échographie
Les fractures associées tibiale ou fémorale peuvent nécessiter un complément d’imagerie par scanner avant une prise en charge précoce pour réduction et ostéosynthèse. À ce stade, il n’est pas toujours évident de diagnostiquer des lésions ostéochondrales associées. Cependant, celle-ci nécessite une prise en charge précoce pour ostéosynthèse. Des lésions de l’appareil extenseur, constituées par les ruptures du tendon quadricipital, du tendon patellaire ou des fractures de la patella, nécessitent une prise en charge précoce. En cas de doute diagnostic, une échographie de l’appareil extenseur peut-être utile.
Bilan électromyographique
Une atteinte du nerf fibulaire commun est retrouvée dans 10 à 30 % des cas, le plus souvent la récupération est spontanée. Le diagnostic précoce d’un déficit neurologique permet d’en informer le patient et de mettre en place dans les jours qui suivent le traumatisme une prise en charge rééducative visant à éviter les rétractions tendineuses et la mise en place d’orthèse posturale anti-équin. Un bilan électromyographique peut être réalisé initialement et surtout à 3 mois en l’absence de récupération afin d’envisager une chirurgie neurologique adaptée.
Prise en charge en aigu (jusqu’à 3 semaines post-traumatiques)
Analyse précise des lésions
La prise en charge initiale des lésions ligamentaires est une urgence différée jusqu’à 15 à 21 jours post-traumatiques. Une IRM sera réalisée pour le bilan lésionnel précis. La prise en charge est différée de quelques jours permettant de passer “l’orage inflammatoire“ et de diminuer le risque de syndrome de loge post-traumatique. L’analyse précise des lésions permettra de mettre en place la stratégie thérapeutique. Celle-ci sera également conditionnée par les complications précoces vasculaires. L’analyse précise du plan thérapeutique est indispensable afin de planifier la gestion des greffes pour les reconstructions souvent multiples : prélèvements ischio-jambiers, tendon patellaire ou tendon quadricipital, allogreffes…
Chirurgie ligamentaire
Pour schématiser la prise en charge ligamentaire, certains principes doivent être respectés.
• En premier lieu, le genou doit être “centré“, c’est-à-dire qu’il faudra corriger la laxité postérieure.
• En cas de rupture du ligament croisé postérieur (LCP) en plein corps ligamentaire, une reconstruction par ligamentoplastie peut être réalisée avec autogreffe, allogreffe ou ligament synthétique.
• En cas d’avulsion de la surface rétrospinale, une réinsertion par vissage direct peut être réalisée.
• Classiquement, le plan ligamentaire latéral nécessite une réinsertion et ligamentoplastie, le plan ligamentaire médial est souvent le siège de décollements ostéo-périostés avec un pronostic de cicatrisation plus élevé.
• En cas de rupture du plan médial avec rétraction, une stratégie chirurgicale devra être envisagée. Le ligament croisé antérieur pourra être pris en charge secondairement à distance.
Cette chirurgie ligamentaire multiple et complexe doit être réalisée dans des centres d’expertise rompus à ce type de chirurgie. Outre une IRM, le bilan sera systématiquement complété par un testing radiographique dynamique préopératoire afin d’analyser l’ensemble des composantes de la laxité.
Prise en charge postopératoire
Immobilisation prolongée
La prise en charge postopératoire nécessite habituellement une immobilisation prolongée afin de permettre de préserver les différents plans ligamentaires reconstruits. Une attelle articulée est mise en place dans notre pratique avec au minimum 1 mois sans appui et une limitation des amplitudes articulaires entre 20° et 90° de flexion ce premier mois.
Rééducation
La mobilisation est très progressive sous couvert de l’attelle et les premières séances de rééducation seront essentiellement fondées le premier mois sur la physiothérapie et le drainage. La reprise progressive de l’appui se fait à partir de 4 à 6 semaines sous couvert de l’attelle articulée en mobilité libre jusqu’au troisième mois postopératoire.
En cas de raideur articulaire
En cas de raideur articulaire, une arthrolyse ou une mobilisation sous anesthésie sera réalisée entre
6 semaines et 3 mois postopératoires. Cette arthrolyse est très souvent nécessaire et le patient doit en être informé en amont.
Prise en charge à la phase chronique
Analyse précise de la laxité
En cas de prise en charge différée (plus de 3 semaines post-traumatiques), une analyse précise des composantes de la laxité doit être réalisée avec IRM et bilan radiographique dynamique.
Ligamentoplasties via allogreffes et autogreffes
L’ensemble des composantes de la laxité devra être pris en charge et il n’y a plus de place pour les sutures ou les réinsertions, chacun des groupes ligamentaires devra être reconstruit par des ligamentoplasties faisant appel à des allogreffes ou des autogreffes. Les laxités devront être réductibles.
Ostéotomies
Dans certains cas, la chirurgie au stade chronique pourra également faire appel à des ostéotomies, notamment dans le cadre de laxité en varus sur un morphotype varus, une ostéotomie tibiale de valgisation pourra être nécessaire. Ces ostéotomies peuvent être isolées ou associées à la ligamentoplastie pour la protéger.
Les résultats fonctionnels sont globalement moins bons lorsque la prise en charge a été réalisée à la phase chronique. En cas d’arthrose post-traumatique, la prise en charge ligamentaire est au second plan et le traitement sera celui de l’arthrose.
Conclusion
La luxation du genou est une lésion rare, mais non exceptionnelle. Une prise en charge adaptée sur le terrain permet d’améliorer le pronostic fonctionnel, bien que celui-ci soit réservé avec l’apparition d’arthrose post-traumatique dans plus de 40 % des cas à 10 ans. L’enjeu initial majeur est la traque des lésions vasculaires et le transfert systématique vers un plateau technique spécialisé avec unité vasculaire pour un examen vasculaire systématique y compris en présence des pouls distaux. La réduction doit être rapide et sans délai.
La prise en charge chirurgicale orthopédique peut être différée de quelques jours, mais doit être réalisée avant les 3 semaines post-traumatiques afin d’améliorer le pronostic fonctionnel. Cette prise en charge sera réalisée par une équipe spécialisée rompue à cette spécificité. L’ensemble des composantes de la laxité sera traité. Au stade chronique, la prise en charge chirurgicale donne de moins bons résultats fonctionnels. n

