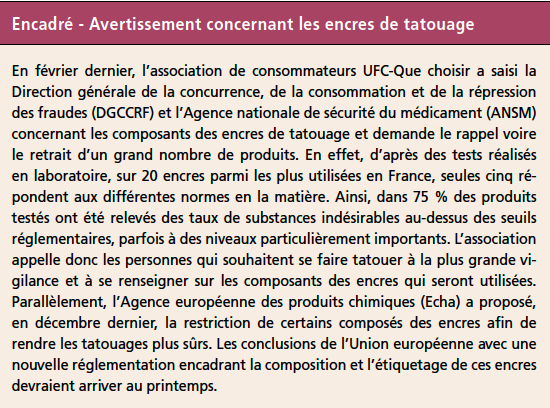Tatouages et sport : une pratique à ne pas négliger
Introduction
Les traces de marquage de la peau se perdent dans la nuit des temps (Ötzi, homme du Néolithique retrouvé en 1991 dans un glacier à la frontière de l’Autriche et de l’Italie a été tatoué à plusieurs reprises sur la face postérieure des jambes, autour de la cheville droite et au niveau du rachis lombaire) (1). On note actuellement un retour en force du tatouage et le milieu sportif ne fait pas exception, bien au contraire.
Véritables œuvres d’art pour certains, symboles personnels pour d’autres, les tatouages évoquent souvent une histoire. Ils sont fréquents chez les sportifs et sportives, dans tous les sports, à tous les âges et dans toutes les zones du corps. 34 % des footballeurs de la Coupe du monde de football 2018 étaient tatoués ; on estime que 20 % des joueurs et joueuses de tennis sont tatoués (Fig. 1).

Définition du tatouage
C’est l’introduction de pigments ou de colorants dans le derme.
Il n’existe pas de diplôme officiel de “tatoueur”, mais une législation fixe les conditions d’hygiène et d’utilisation des encres ; des dispositions concernant la pratique du tatouage sont inscrites dans le code de santé publique.
La peau et les ganglions du sportif
La peau
La peau représente une interface aux intérêts multiples (2) et sera parfois soumise à rude épreuve dans certains sports (contacts, frottements, hématomes, plaies, soleil…). Un organe des cinq sens, elle représente 18 % du poids du corps pour 18 000 cm2 ; c’est un bouclier contre les infections, une ombrelle contre le soleil, un parapluie, un élément de la synthèse de la vitamine D.
Le revêtement cutané respire, élimine, protège, pèle, s’étire, se dilate, et souffre parfois ; certains dermatologues n’ont pas hésité à parler de la peau comme d’un “miroir de l’âme” ou d’un “cerveau étalé”.
Il est donc intéressant de voir les éventuelles conséquences des tatouages sur une peau soumise à une pratique sportive parfois intensive.
Encre et ganglions lymphatiques
L’encre du tatouage “tatoue” aussi les ganglions lymphatiques ; une partie de l’encre est phagocytée par les macrophages du système immunitaire et éliminée par la lymphe. Le composé migrateur est le dioxyde de titane utilisé pour blanchir les couleurs.
Cette “contamination” ganglionnaire par l’encre va poser des problèmes d’interprétation en imagerie radiologique et lors des analyses de ganglions sentinelles (3).
Les complications des tatouages chez le sportif
Cutanées
On estime que 6 % des personnes tatouées décrivent des problèmes chroniques liés à leurs tatouages (une consultation dirigée par le Dr Kluger à l’hôpital Bichat de Paris est spécialement dédiée à cette problématique).
C’est souvent une réaction à l’encre utilisée, surtout la couleur rouge.
Complications aiguës (4)
Elles sont immédiates ou surviennent durant la cicatrisation (2 à 3 semaines) avec un état local inflammatoire (rougeur, œdème, induration, douleur), avec un prurit parfois important.
Cet état sera traité de façon locale et ne sera inquiétant que s’il se prolonge au-delà de 30 jours.
Eczéma de contact
Des lésions de type eczéma peuvent survenir, même longtemps après la phase initiale et persister ; on retrouvera souvent des lésions prurigineuses et vésiculeuses surtout en périphérie du tatouage (5).
Un traitement corticoïde local sera alors nécessaire.
Adénopathies localisées transitoires
Elles peuvent survenir sur le réseau ganglionnaire concerné dans la région anatomique où le marquage a été effectué ; quelquefois légèrement douloureuses, elles ne nécessitent pas véritablement de traitement.
Infections cutanées et systémiques
Elles sont dues à l’introduction d’un germe durant l’acte ou à une contamination pendant la cicatrisation (6). On retrouve des lésions superficielles avec inflammation locale, croûtes et aspect purulent (type impétigo, ecthyma, érésipèle, abcès, folliculite) (Fig. 2 et 3).


Le traitement sera local le plus souvent avec nettoyage antiseptique et application de crème antibiotique. Des prélèvements bactériologiques avec antibiogramme sont parfois réalisés et un traitement antibiotique par voie générale peut être proposé.
Les infections profondes et sévères sont rares et très souvent dues à des encres infectées (mycobactéries).
Transmission du VIH et de l’hépatite C
Elle est exceptionnelle ; il n’y a pas de véritable risque pour la transmission du virus de l’hépatite C.
Endocardite
De rares cas d’endocardites aiguës sont retrouvés dans la littérature, tous survenus chez des patients porteurs de cardiopathies.
Sensibilité aux colorants
Les sportifs “sensibles” à certains colorants vont présenter des signes cliniques “en réaction” à ces pigments colorés ; cette “réaction” peut survenir immédiatement ou tardivement. Cliniquement, on note un prurit parfois intense avec des nodules ou papules (réaction lichénoïde ou eczématiforme).
Un traitement local par dermocorticoïdes de forte activité sera nécessaire pendant plusieurs semaines.
En cause : les couleurs rouges, roses et violettes, qui ne devront plus être utilisées par le sportif pour un éventuel nouveau tatouage.
Phénomène de Koebner
Un sujet sportif porteur d’une dermatose chronique devra être méfiant car la dermatose risque d’apparaître sur le trajet du tatouage. Cette notion est importante à connaître pour le staff médical (information, prévention).
Étude sur la sudation et la physiologie de la peau tatouée
M. Luetkemieier et collaborateurs (Alma Collège, Michigan) (7) ont démarré une étude visant à mettre en évidence une éventuelle altération du processus de sudation pendant l’effort physique par l’encre de tatouage. L’étude n’a porté que sur dix athlètes de haut niveau, mais montre que la transpiration est deux fois moins abondante dans les zones tatouées en raison d’un ralentissement de la réponse des glandes sudoripares.
Ce travail est toujours en cours pour affiner et confirmer les premiers résultats et les confronter à ceux de Chalmers et collaborateurs (8).
En Allemagne, à l’université des sports allemands de Cologne, Frobose et collaborateurs ont mené des études sur les footballeurs professionnels tatoués (sudation, essai de dosage de l’encre des tatouages, sérologies immunologiques) et proposent radicalement l’interdiction de tatouage aux joueurs de football professionnels arguant la baisse de performance après un tatouage (9).
Psychologiques
La principale conséquence est le regret associé à la déception. Cet “état d’âme” après un tatouage survient souvent quand la décision de se faire tatouer a été prise de façon impulsive ou sous l’influence de l’alcool (troisième mi-temps arrosée, euphorie après une victoire ou une bonne performance). Le regret peut survenir également quand le tatouage ne répond plus à l’attente du sportif.
Pourquoi se faire tatouer ?
Pour suivre le phénomène de mode
Les sportifs professionnels montrent souvent leurs tatouages dans la presse et sur les réseaux sociaux (Instagram), ce qui peut motiver les “amateurs” à en faire autant (10).
Pour appartenir à un groupe
Un exemple significatif est celui des rugbymen de la ville d’Issoire ; pour fêter leur titre de champion de France de fédérale 2, tous les joueurs ont décidé de se faire tatouer le même motif (la date de leur titre en chiffre romain soit XXIII.VI.XIX.).
Pour se souvenir d’un bon ou mauvais moment dans sa carrière sportive ou sa vie familiale
Par exemple, le cycliste professionnel Oscar Pereiro s’est fait tatouer “Colle del Agnello 2008” à côté de la cicatrice chirurgicale faite après sa fracture grave de l’humérus gauche due à une chute sévère dans la descente du Col d’Agnel. Le footballeur de Marseille, B. Kamara, a “marqué” la naissance de son fils par un marquage sur le mollet ; un marathonien américain a fait reproduire, en tatouage, sur son crâne, la cicatrice que porte son fils suite à une neurochirurgie pour tumeur cérébrale (Fig. 4).

Dans un but “thérapeutique” (11)
Pour masquer ou transformer une cicatrice existante, souvent après une chirurgie ou une reconstruction pour cancer du sein (tatouage pour redessiner l’aréole du sein, et même le mamelon entier) ; dans certains cas ce tatouage thérapeutique peut être pris en charge par l’Assurance maladie.
En orthopédie, une cicatrice de chirurgie du genou a été transformée par le tatoueur en arête de poisson (Fig. 5) ; de même une cicatrice sur la cuisse suite à une tumeur maligne a été modifiée en “lacet”.

Le médecin – le sportif – le tatouage
Le médecin du sport, de club, d’équipe…
Pour un premier tatouage
Envisagé ou programmé
Si le médecin est au courant de l’intention ou du rendez-vous pris, il semble nécessaire d’informer le sportif de :
• ne pas se faire tatouer en période de compétition,
• choisir un tatoueur fiable et reconnu,
• se méfier des couleurs, surtout le rouge et ses dérivés,
• faire attention en cas de dermatose existante,
• ne pas se faire tatouer si le système immunitaire est affaibli (suite d’épisode viral ou infectieux),
• éviter le sport pendant 3 semaines après le geste,
• effectuer une réflexion générale avant cette décision.
Après un premier tatouage récent
Le praticien ne devra pas montrer de gêne à vouloir “surveiller” ce tatouage, à mener un interrogatoire à la recherche de symptômes (prurit) ou de signes cliniques, en restant concentré sur la clinique et l’évolution de la cicatrisation.
Il n’hésitera pas à revoir “la plaie”, à la surveiller, à rechercher une éventuelle adénopathie et à proposer un traitement local si besoin.
Chez un athlète “multi-tatoué”
La situation “médicale” sera différente, car le sportif aura une expérience. En revanche, elle ne dispensera pas le médecin de surveiller la situation, surtout si de nouvelles couleurs ont été utilisées.
Un protocole tatouage
La multiplication des tatouages dans le milieu sportif amène les entraîneurs, dirigeants ou présidents à questionner le staff médical et à vouloir mettre au point un protocole “tatouage” (risques, assurances, prise en charge si problème).
L’anesthésiste et la sportive tatouée
C’est le problème de la péridurale qui est souvent posé (12). Si le tatouage est dans la région anatomique concernée par le point de “piqûre”, certains anesthésistes refusent de “piquer”, d’autres font une “carotte” (13). Un travail précis du
Dr Kluger sur ce sujet l’amène à déclarer qu’il n’y a pas de problème pour réaliser une péridurale sur une zone tatouée (14). Le médecin pourra malgré tout prévenir la sportive de cette problématique s’il est informé d’une péridurale.
Le radiologue et l’oncologue
Ces deux spécialités sont de mieux en mieux informées des troubles de l’imagerie provoqués par l’encre des tatouages dans les ganglions lymphatiques.
Le psychiatre
Il peut être parfois consulté par un sportif dans le doute, le regret, un état dépressif ou sur les conseils du médecin de club. Il est souvent très réticent, voire parfois opposé au “marquage”, à “l’ancrage”, au “traçage pour la vie” de jeunes sportifs ou sportives. Chaque psychiatre aura sa propre approche, mais son avis sera utile pour le médecin et le “patient” en cas de volonté de se faire tatouer malgré les risques connus.
Le chirurgien
Il est souvent confronté au fait de devoir éventuellement inciser un tatouage et entendre les doléances des sportifs à ce sujet ; il va, dans la mesure du possible, tenir compte du “dessin”.
Un chirurgien espagnol avait pris en charge un joueur de football international de l’équipe d’Espagne qui avait un grave problème de cicatrisation au niveau d’une cheville (après une chirurgie ligamentaire en Angleterre). Devant la gravité de la situation, une greffe de peau a été réalisée, mais avec de la peau de l’avant-bras qui était tatouée (prénom de la fille du joueur). Une partie du tatouage de l’avant-bras s’est donc retrouvée sur la cheville ; le résultat fonctionnel a été très bon, mais l’esthétique un peu moins (un demi-tatouage sur la cheville, l’autre sur l’avant-bras…) (Fig. 6).

L’urgentiste
Un courant de pensée contre l’acharnement thérapeutique encourage l’utilisation du tatouage pour avertir le corps médical et les secouristes de cette doléance. À l’hôpital universitaire de Miami, les urgentistes ont reçu un coureur à pied, 70 ans, en état de choc avec un tatouage “Do not resuscitate” sur le thorax (15) ; après réunion, le staff médical décide de ne rien faire et le décès sera constaté le lendemain (Fig. 7).

Le rééducateur, le kinésithérapeute
On ne constate pas de difficultés particulières pour la rééducation ; le kinésithérapeute pourra travailler une cicatrisation difficile du tatouage.
Conclusions
La médecine du sport, des sportifs en général, doit “s’emparer” du sujet du tatouage, car le corps de ces pratiquants a été agressé, voire “mutilé”. Quelle que soit sa connotation, le tatouage ne sera pas négligé par le médecin qui devra le surveiller cliniquement comme tout suivi de la peau du sportif.
Le praticien, confronté au psychique et au physique (16) de son “patient” sportif ne remplacera pas Freud, mais il est cependant important de différencier les tatouages des autres modifications corporelles (17) et de savoir en parler avec la personne (avant et après le tatouage), surtout chez les jeunes.
Bibliographie
1. Renaut L. Les tatouages d’Ötzi et la petite chirurgie traditionnelle. Anthropologie 2004 ; 108-1 : 69-105.
2. Julia M, Gasq D, Vaucher et al. La peau en médecine du sport. 2015 Sauramps Médical.
3. Sermondadaz S. La migration de l’encre des tatouages vers les ganglions observée au Synchroton de Grenoble. Sciences & Avenir 2017.
4. Kluger N. Complications des tatouages. Rev Prat Med Gen 2018 ; 1001 : 381-83.
5. Kluger N. Réactions dites « allergiques » aux tatouages : prise en charge et algorithme thérapeutique. Ann Dermatol Venereol 2016 ; 143 : 436-45.
6. Kluger N. Cutaneous and systemic complications associated with tatooing. Presse Med 2016 ; 45 : 567-76.
7. Luetkemeier MJ, Hanisko JM, Aho KM. Skin tattoos alter sweat rate and Na+ concentration. Med Sci Sports Exerc 2017 ; 49 : 1432-6.
8. Chalmers S, Harwood AE. Do tattoos impair sweating? J Sci Med Sport 2019 ; 22 : 1173-4.
9. Goodman S. They ink it’s all over Top footballers are wreeking their performances by having tattoos, claim experts. The Sun 2017.
10. Pondevie F. Le tatouage à fleur de peau. Cycle 2018 ; 501 : 88-90.
11. Cipriani-Crauste M. Le tatouage dans tous ses états. 2008. L’Harmattan.
12. Douglas MJ, Swenerton JE. Epidural anesthesia in three parturients with lumbar tattoos: a review of possible implications. Can J Anesth 2002 ; 49 : 1057-60.
13. Kuczkowski KM. Controversies in labor: lumbar tattoo and labor analgesia. Arch Gynecol Obstet 2005 ; 271 : 187.
14. Kluger N, Fraitag S, Guillot B, Sleth JC. Why puncturing a lumbar tattoo during epidural analgesia cannot induce an epidermoid tumor. Reg Anesth Pain Med 2010 ; 35 :317
15. Holt GE. An unconscious patient with a DNR Tattoo. N Engl J Med 2017 ; 377 ; 22 : 2192-93.
16. Saks O. L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau. 1988. Éditions du Seuil.
17. Fraselles P. Psychanalyse du tatouage et du piercing. 2014. Disponible sur patrickfrasellepsychanalyse.over-blog.com.